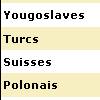Je crois que je me sens de plus en plus Bisontine.
Par habitude ?
Le temps a sans doute commencé à faire son œuvre !
Bisontine d’adoption depuis quinze ans. Je me surprends à me dire : déjà !
Certains me disaient : c’est tout ! tu viens juste d’arriver en France !
Une question récurrente aussi : « est-ce que tu ne comptes pas un jour retourner chez toi !! »
Ah ! le vieux mythe du retour, comme s’il devait obligatoirement s’inscrire dans tout parcours migratoire. Tout ? non je ne crois pas. Je ne crois pas qu’il vienne à l’idée de quiconque de poser cette question à un Américain ou un Européen.
Paradoxalement ce ne sont pas les « vieux immigrés » qui me posaient la question. Eux, ne se posent pas ou ne se posent plus la question.
Est-ce qu’un jour je me réinstallerai dans mon pays ? NON. Définitivement non. Maintenant, mais aussi dès mon arrivée à Besançon j’ai su que la France est définitivement mon pays. D’ailleurs, quelque part la France a toujours été mon pays. J’ai toujours eu des attaches particulières avec la France, sa culture, sa langue. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours parlé le français. Pour moi c’est aussi ma langue maternelle.
Lorsqu’on me pose cette question du retour, que je finis par trouver indécente, c’est au fonds me dire : tu n’es pas chez toi ici. On s’image que lorsqu’on a quitté l’endroit où l’on est né, où l’on a longtemps vécu, il ne s’agit que d’un changement géographique.
Voulu, ou imposé par les circonstances, l’exil est un atroce déchirement. Je dirai même charnel. On laisse derrière nous tout ce et ceux qu’on a aimés et lentement, insidieusement notre empreinte s’efface et il en faut du temps pour qu’elle s’inscrive dans notre terre d’accueil. Notre pays doit-il être exclusivement et à jamais notre pays natal. N’est-il pas aussi et surtout celui où l’on vit chaque jour, celui où l’on a tissé nos réseaux sociaux et professionnels, celui où l’on s’enracine désormais parce que nos enfants y ont planté les leurs. Notre pays n’est-il pas simplement notre pays de cœur et pas seulement une entité administrative.
Premières années à Besançon
Lorsque je me remémore mes premières années à Besançon, c’est toujours l’image de ces cosmonautes dans le noir sidéral qui me vient à l’esprit, mais eux étaient rattachés à leur navette spatiale par un très solide filin. Moi, j’avais le sentiment d’être dans ce même espace sidéral mais sans filin. Ce filin symbolique n’existait pas pour moi. Je ne me sentais rattachée à rien. Du jour au lendemain, plus d’ami, plus de famille, plus de boulot, plus de maison. Dure la chute ! Il est vrai qu’avant mon départ précipité pour la France, j’avais un travail que j’aimais beaucoup, une situation sociale plus que correcte, mais ce n’était pas ce qui me manquait le plus. Non ce qui manquait c’était ces petites choses qui font le sel de la vie. Ces petits objets, ces photos, qui n’ont pas nécessairement une grande valeur marchande, mais qui représentent toute votre richesse, pas matérielle encore une fois. Ils vous racontent des histoires. Des histoires de votre vie. Des choses qui font que vous appartenez à un cercle de vie, que vous êtes une branche d’un grand arbre. Toutes ces petites choses concrètes ou virtuelles qui font simplement que vous existez. Oui, assurément c’était tout cela qui me manquait. Cette absence faisait que je ne me sentais rattachée à rien, que je n’avais plus d’Histoire. J’avais ce sentiment bizarre que j’étais quelque part en haut et que je me regardais vivre en bas. Mais il ne fallait pas regarder en arrière au risque de se perdre. Garder la tête hors de l’eau, se battre pour une autre vie. Se battre pour les enfants, pour qu’ils n’éprouvent jamais un sentiment d’insécurité, pour qu’ils puissent suivre une scolarité normale et avant tout rattraper leur retard linguistique. Ce dernier était mon souci principal, si les enfants arrivaient à combler le retard linguistique très rapidement, je savais qu’ils seraient sauvés car ils ont toujours eu de très bons résultats scolaires. Il y avait très peu d’argent chez nous mais la priorité a été de les inscrire au cours de français par correspondance pendant tout l’été afin d’être au top à la rentrée de septembre (nous étions arrivés en France en juin). L’été a donc été éprouvant. Il fallait avaler en trois mois le programme de plusieurs années, pour que les enfants soient au même niveau que leurs camarades. Pour moi, c’était une obsession mais elle a été payante puisque les enfants ont suivi une scolarité et des études universitaires normales. Et comme ils sont jeunes, beaucoup croient qu’ils sont nés et ont grandi ici. En cela, je crois que j’ai réussi.
En ce qui me concerne plus particulièrement, je savais que plus jamais je ne retrouverai la situation que j’avais auparavant. Je savais qu’il fallait tourner la page et vivre autrement, mais il fallait plus que jamais assurer l’avenir des enfants. Je ne pensais plus à moi. Je n’en n’avais ni le temps ni le loisir. Il fallait être encore et toujours une locomotive. Il fallait se battre pour survivre, ne pas se laisser entrainer dans des batailles stériles, se battre pour rester une personne à part entière, ne pas être dépossédée de sa vie sous prétexte que d’autres savent et donc s’arrogent le droit de faire et parler à votre place. Pouvoir faire soi-même toutes ces démarches administratives qui vous donnent une existence. Garder son entière autonomie. S’enfermer dans une bulle pour ne pas entendre des réflexions malveillantes. Avec le temps, je me dis qu’elles étaient plus stupides que malveillantes, mais lorsque la vie vous a blessée, les mots, les gestes des autres résonnent en vous d’une façon bien particulière. Et c’est là, que tout vous fait mal, surtout lorsque vous n’avez pas choisi de vous exiler et que c’est la guerre civile qui vous a poussée dehors. Parfois quelques bribes me reviennent : « On donne du travail à des réfugiés mais on exclut des immigrés qui sont là depuis trente ans ». Certains me déniaient toute opinion, alors j’avais droit à des « mais qu’est-ce que tu connais de la France toi ! ». Il y a eu aussi les étonnements sur ma maîtrise de la langue française et cette flèche perfide assénée un jour « A t’entendre, on croirait que tu connais parfaitement le français mais quand tu écris, on sent que la colonisation est passé par là ». Oups !!
Encore des mots qui font mal parce qu’ils te renvoient à ta situation de dénuement. Un jour, j’étais dans un self. La personne avec qui je devais déjeuner arrive surexcitée et déclare d’une voix de stentor : « j’ai dit à toutes les personnes que je connais, de ne pas se débarrasser des choses qu’ils voulaient jeter à la poubelle pour te les donner. » En me tendant ostensiblement les clés de sa maison de campagne qu’elle me proposait d’occuper pendant son absence, elle ajoute « vous pourrez utiliser les serviettes que vous voudrez parce que de toutes façons après, je les jetterai toutes à la poubelle ». Quelle honte ! J’avais l’impression que tout le monde dans la salle me regardait. Le leit motiv de mon vis à vis était : « cherche juste un petit boulot alimentaire comme femme de ménage ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas la peine de chercher quelque chose en rapport avec ton niveau universitaire. » !!!! Cette personne m’a beaucoup aidée à mon arrivée à Besançon, mais j’avais le sentiment qu’avec toutes ses réflexions, elle tenait à me faire comprendre que ceux qui sont au bas de l’échelle doivent y rester pour toujours.
J’ai plus galéré que travaillé
Si je me suis laissée aller à ces souvenirs, ce n’est ni par amertume ni par rancœur, c’est simplement pour dire que la vie peut jouer de mauvais tours y compris à ceux qui se croyaient à l’abri de tout. Ce n’est pas parce qu’à un moment de notre vie (immigré ou pas d’ailleurs) on se retrouve dans une situation délicate que certains peuvent se permettre de mettre à bas la dignité des gens. Plusieurs personnes d’origine étrangère m’ont confié « combien il est difficile pour un étranger de se faire une place. »
C’est vrai, qu’il est difficile pour tous de faire une place dans la société, mais parfois c’est plus difficile pour ceux qui viennent de l’étranger. Je ne veux pas faire référence au racisme ou aux discriminations. Le système de référence est sans doute trop rigide.
A notre arrivée, nous n’avons eu aucun problème dans nos différentes démarches administratives, mais en une quinzaine d’année, malgré mon expérience professionnelle, mes compétences, j’ai plus galéré que travaillé. Les emplois que j’ai occupés l’ont été grâce à des mains tendues. Je ne compte plus les actes de candidature restés lettres mortes. Les entretiens d’embauche ont été extrêmement rares et sans me connaitre on me glissait que la notion du temps dans mon pays n’était pas la même. Je me rappelle d’un entretien qui, pensais-je, se déroulait bien. Je me sentais alors de plus en plus en confiance jusqu’à ce que mon interlocuteur me dise : « j’ai retenu deux candidatures dont la vôtre. Je sais que j’ai fait mon choix, mais j’étais très curieux de savoir comment vous étiez arrivée à votre dernier poste. »
J’ai alors tout de suite compris que la seule motivation de mon interlocuteur était de vérifier que mon C.V. n’était pas celui d’une affabulatrice.
On m’a également dit que j’étais trop diplômée, que j’avais trop de capacités et qu’alors je m’ennuierai dans mon travail. J’ai commencé à perdre pied, à perdre confiance en moi, j’ai réduit mon C.V. au minimum vital. Je voulais juste avoir un travail, même s’il n’était pas à la hauteur de ce à quoi je pouvais prétendre. Mes entretiens à l’ANPE dépassaient rarement les trois minutes et j’étais renvoyée chez moi avec un « vous savez il y a tellement de jeunes au chômage ». Lorsque j’ai eu la cinquantaine, un imprimé de l’ANPE a commencé à fréquenter assidûment ma boite aux lettres, c’était une demande de dispense de recherche d’emploi. C’est aussi une solution pour réduire les chiffres du chômage !! Je sais que mon parcours n’est pas unique et je me dis souvent quel gâchis !!
De toute mon histoire, je crois que le traumatisme qui ne s’effacera jamais, c’est lorsque j’ai été réduite à demander le RMI. Pour moi, j’avais touché le fond du fond. D’aucun pourrait dire, « mais il fallait retourner dan ton pays » Oui, mais si je l’avais fait, aujourd’hui, je serai plus là.
Après des années de galère, une main s’est tendue et m’a permis d’occuper mon emploi actuel.
Aujourd’hui, les blessures se cicatrisent, la sérénité s’installe en moi (même si je sais que l’avenir reste très incertain pour moi parce que je ne pourrais pas prétendre à une retraite).
Je commence à aimer Besançon. Au fonds de moi, je pense que je m’y suis attachée, attachée aussi aux gens que j’ai rencontrés. Les épreuves m’ont révélé une force intérieure que je n’avais jamais soupçonnée.
Propos recueillis par Farida TOUATI, décembre 2010, témoignage anonyme.
Besançon, France