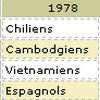Non, les coups dans la porte, les cris, ce n’était pas dans un cauchemar. Elle entendait maintenant, bien réelles, de grosses voix étrangères, menaçant dans le couloir.
Et puis, étranglées, des voix qu’elle reconnaissait à peine.
Bruits de bottes. Elle osait à peine regarder. Silhouettes fugitives de ses parents, peut-être aussi de sa petite sœur. Va-et-vient d’hommes en treillis. Le nom de la famille se trouvait sur leur liste, disaient-ils, tout en agitant un cahier noir. Il fallait rendre les armes cachées. Sinon…
Et puis l’un des soldats – le plus grand – fait irruption dans la chambre, arrache le drap, la déshabille. Elle se rabougrit dans le lit, le froid du ventre armé sur son ventre à elle, nu. « Srir ! Srir (« petite ») ! » crie alors sa mère dans l’encadrement de la porte, serrée contre son père. Alors il se relève, marche vers elle, sa nouvelle proie. Des pas de mort, des voix de nuit. Plus personne dans le couloir. Un autre homme entre dans sa chambre, pointe son fusil sur elle. Son frère dort-il encore dans le lit voisin ?
Un cri de terreur « au secours ! » -la nuit se déchire- en écho un prénom hurlé, « Marcelle », sa mère, si loin si loin.
Près d’une heure d’angoisse -elle mettra le lendemain au fond d’un tiroir son réveil, témoin de l’arrêt du temps, de la vie, cette nuit-là – Son regard va du fusil sur son ventre aux barreaux de la fenêtre. Disparaître. A chaque mouvement le doigt du soldat se pose sur la gâchette. Elle tente deux trois mots n’importe quoi, essayant de l’amadouer, honteuse d’elle-même.
Soudain les portes s’ouvrent, les hommes fuient, brandissant encore fusils et couteaux dans la lumière crue du couloir. « Skut ! Skut ! ».
Alors tous les cinq figés les uns contre les autres, en larmes muettes, rejoints un peu plus tard par les voisins.
La nuit du 14 juillet 1962 se terminait, l’enfance et l’Algérie aussi.
Il fallait désormais fuir.

Dès le lendemain, la voisine et ses enfants prirent l’avion pour la France. En attendant des places sur un bateau, la famille trouvait refuge dans le centre ville. Les appartements abandonnés précipitamment par les pieds-noirs ne manquaient pas. Ici une vaisselle séchait sur l’égouttoir, là les lits étaient défaits. Nuits blanches de désespoirs mêlés.
***
L’exil en France ne nous libéra pas de la peur.
Je revécus longtemps dans mes rêves la nuit du 14 juillet, réveillée parfois par mes propres cris.
Au fil des ans, le récit de ma mère devint un leitmotiv, dans lequel je ne voulais entendre que la rancune des vaincus. Je bannissais l’Algérie des conversations avec mes parents, restais sourde aux histoires de là-bas, regardais distraitement les photos anciennes, tournais le dos au passé, haussais les épaules aux reproches de ma mère : « Tu oublies ce qu’ils ont failli te faire ! ». Je la faisais taire sèchement, et lui opposais les chiffres des victimes algériennes.
La douleur s’enkystait, il n’y aurait pas de guérison.
Vint le temps des deuils.
Un autre 14 juillet emporta mon père dans le bruit des pétards et des feux d’artifice.
En maison de retraite, ma mère se croyait parfois de retour dans son Algérie.
Un soir au téléphone, une voix blanche. Mon frère. Quelques mots brefs.
Bien plus tard seulement il pourrait écrire :
« 1997, la directrice de la maison de retraite appelle : passez s’il vous plaît, des choses que je ne peux pas vous dire au téléphone. Son petit bureau, l’odeur fade, vaguement triste des maisons de retraite. Votre mère a fait peur à tout son groupe de parole ce matin. Elle a raconté qu’elle avait été violée, avec beaucoup de détails. Toutes les dames pleuraient. Je ne sais pas si c’est vrai, mais il faut qu’elle arrête de faire peur comme ça à aux autres dames, les groupes de parole ça n’est pas fait pour ça.
J’ai bafouillé. Ma mère a dû parler de ce qui est arrivé en Algérie, en 1962. Il n’y a pas eu viol, juste la peur de l’intrusion d’hommes armés. Puis j’ai été submergé par les larmes. Je me suis rappelé le cri de ma mère, le cri de mon père comme sortis du diable que l’on ouvre. Le forceps.
La directrice en face de moi, vaguement ennuyée. S’il vous plait, Monsieur, calmez-vous. Puisque vous dites qu’il ne s’est rien passé. Dites à votre mère que ce n’est pas bon, ni pour elle ni pour les autres de remuer tout ça. Au revoir Monsieur.
Ma mère qui attend, dans le hall, assise sur une petite chaise. La directrice, elle t’a rien dit de mal sur moi ? L’embrasser en pleurant. Non, bien sûr. Rien de grave. Sois tranquille. Je viendrai te chercher dimanche. Ma mère collée à la porte vitrée. De petits gestes d’au revoir, tant qu’elle peut me voir. »
Pour la première fois nous parlons ; en retenant nos larmes, nous mettons en commun les bribes de nos souvenirs d’enfants. Ma sœur se rappelle notre mère jetée violemment sur le lit, mon frère se souvient du bruit d’eau dans la salle de bains après le départ des soldats, moi d’un rendez-vous pris d’urgence chez le médecin. Le drame se reconstitue, d’une évidence brutale.
Peut-être notre mère a-t-elle parfois cherché à se délivrer du secret ? Peut-être n’avons-nous pas su l’entendre ?
Aujourd’hui je lui rends hommage. En criant « srir », elle m’a sauvée ; par son silence, elle nous a mis à l’abri de sa souffrance.

Je ferme les yeux et je la vois ; elle a le visage des femmes bosniaques ou tchétchènes.
Les armes n’auront pas eu raison. Le crime ne se tapit plus dans la nuit du non dit. Il surgit enfin en pleine lumière, monstrueux. Maintenant je peux l’abattre.
Je pense à elle, disparue peu de temps après sa douloureuse confidence. Je rêve parfois que je peux lui dire, Je sais maintenant, je hais ton violeur. Je la serre dans mes bras et je lui dis encore, je suis retournée à Sidi-Bel-Abbès, dans notre maison. On m’y a accueillie avec bienveillance. Dans le couloir, devant la porte fermée de ta chambre j’ai murmuré tout doucement ton prénom, « Marcelle ».
Elisabeth Trouche texte inséré : Luc Trouche
Algérie